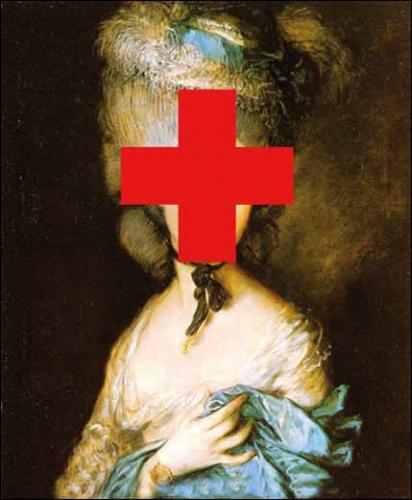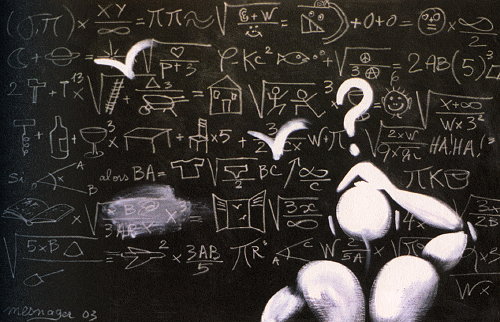Fifou : Alors qui est Fifou… Je suis graphiste même si le terme employé en ce moment c’est photographiste, beaucoup de personnes se présentent ainsi. Ceci dit, en dehors des pochettes et de tout le travail que je fais dans la musique, je suis aussi dessinateur et je travaille sur de nombreux projets dans l’audiovisuel.
Tu as intégré le milieu rap en bossant pour Radikal et Tracklist. Comment ça se passait dans le milieu de la presse ? C'était ton premier contact avec le rap ?
F : Mon premier contact avec le rap remonte à l’époque où j’étais animateur dans une radio hip-hop locale, Vallée Fm, où DJ Mars de Time Bomb avait sa propre émission. J’étais encore au lycée, donc j'observais les freestyles et les interviews avec les yeux qui brillaient [rires]. Je me souviens d'un freestyle de la Brigade et des 2Bal qui avait duré plus de 20 minutes… Je me baladais avec mon carton à dessins et mes carnets de croquis afin de leur montrer… j'étais un fan assumé [rires]
Comment as-tu intégré ces magazines ?
F : A côté de cela, j'étudiais à mon école d’arts appliqués (ENSAAMA) et en tant qu’étudiant, il fallait que je trouve un stage. Mon pote Bob de générations m'a alors présenté à Philippe Caubit, l'ex directeur artistique du magazine Radikal. Après avoir vu mes dessins, il m'a rapidement pris en stage. A ce moment précis, je n'avais jamais touché aux logiciels Photoshop et Illustrator… Je n'avais pas de base du tout, mais malgré cela, Philippe me donnait des "devoirs" à faire [rires]. En deux mois j'ai donc appris a maquetter un magazine et surtout à manier le fameux Photoshop. Ensuite dans Radikal j'ai intégré l'équipe en dehors de mon stage puisque j'y réalisais des illustrations. Philippe Caubit étant devenu un ami, on a continué à collaborer ensemble sur son magazine "Tyler" - entre autre sur des illustrations pour des campagnes Footlocker. Puis, petit à petit, j'ai intégré d'autres équipes de presse comme celle de The Source et Tracklist. C'est là que j'ai vraiment découvert le monde de la presse…Être toujours dans le rush! [rires] Mais bon, je n'ai que des bons souvenirs de cette période. Big up a David Dancre, Leila Lkj, kiki, Nanou, et Hi-Tekk de la Caution.
"Pour moi un photographe mange et vit pour la photo. Moi je me sens plus graphiste et directeur artistique."
Ta formation première c’est graphiste ?
F : J'ai eu la chance d'intégrer une grande école, dans laquelle j'ai pu toucher à tout : modelage, sculpture, peinture, design de produit... Mais ma formation sur "papier" est un BTS de communication visuelle. On t'apprend à réfléchir sur toute forme de communication, que ce soit en édition ou en publicité. On apprend alors le développement marketing d'un produit et sa mise en avant visuelle. L'école c'est beaucoup de théorie mais il me manquait la pratique. En dehors des cours, je travaillais déjà avec pas mal d'artistes, ce qui m'a permis d'être plus complet.
Comment est-ce que tu t’es mis à la photo ?
F : La photo part d’une grande improvisation. J’ai toujours été attiré par la photo sans pour autant m’imaginer photographe. Ce déclic, je le dois à un ami photographe, Christophe Gstalder, de 24 ans mon ainé. Je devais avoir 20 ans, j'étais avec l'équipe de Joey Starr à l'hôtel Costes et j'ai rencontré ce gars. Son book photo était impressionnant : On passait de Enrique Iglesias à Robert de Niro, de Marcello Mastroianni à Mickey Rourke…Bluffant. J'ai alors bossé avec lui sur des directions artistiques de projets musicaux et d'édition.
C’est une sorte de mentor pour toi ?
F : Complètement ! C'est une époque où j'étais H24 avec lui. Sa vie était à l'image de son art : folle, explosive, aérienne… Un vrai artiste. Tu ouvrais le frigo, il y avait des tonnes de pellicules photos, le salon était rempli de tirages argentiques… Je l'ai beaucoup observé et assisté durant ses shootings photos…quand je shoote aujourd'hui, je fais pratiquement les mêmes gestes que lui [rires]. C'est aussi en ayant vu tout ça que je ne me suis jamais donné le statut de photographe. Pour moi un photographe mange et vit pour la photo. Moi je me sens plus graphiste et directeur artistique.
Est-ce que tu es passé par la case graffiti comme d’autres graphistes ?
F : J’ai traîné avec des équipes de graffeurs mais j’étais plus attiré par la peinture, c’est ça qui me faisait kiffer. J’ai plutôt une culture de BD, de mangas, de comics, que de graffiti.
En tant qu’artiste, est-ce que tu as envie de revenir vers tes premières amours et notamment la BD ?
F : Complètement. Mais je n'ai jamais lâché cette passion. En 2006 j'ai monté avec trois associés, une société de production dans l'audiovisuel : Bazookos. Les projets y sont divers et variés mais ont tout un point commun : le dessin. C'est un travail d'acharnés mais excitant. On prépare quatre gros projets d'animation, en partenariat avec d'autres boites de prod et chaines TV. Le plus connu et plus vieux de mes projets est Baby HipHop, crée avec mon ami Clark en 2005. On travaille sur la série et un nouvel album international. 2011 va être rempli d'aller-retours aux US [rires].
Sinon le projet le plus abouti que je prépare est un livre d'illustrations sur l'univers du Gangsta Rap Californien : Comptoonz. Ce livre co-créé avec Chino Brown verra le jour en 2011.
Tu n’as que 27 ans et tu as un book déjà bien rempli en tant que graphiste. Quelles ont été les étapes déterminantes dans ta carrière ?
F : La presse a été vraiment importante parce que cela m’a appris à penser dans l’urgence. C’est un milieu où tu as beaucoup de contraintes, c’est un gros bazar mais c’est un bel apprentissage. Il faut que tu bosses dans l’urgence avec peu de moyens. Surtout dans la presse Hip-Hop hop où les budgets ne sont pas les mêmes que quand tu bosses pour un magazine de mode. Après, l’opportunité de faire les pochettes d’artistes importants m’a propulsé. La pochette du premier album de Lino qui sortait chez EMI m’a permis de rentrer dans le réseau maison de disques et surtout d’être exposé. On ne me connaissait pas forcément avant ça. L’album de Lino et "Illicite projet" sont vraiment les deux disques qui ont donné une autre dimension à ma carrière. Même si "Illicite projet" n’a pas eu les résultats escomptés, ça a fait pas mal de bruit et l’image avait été bien travaillée. Je n’avais pas fait les photos mais c’est moi qui les avait retouchées, qui avaient fait des montages, qui les avaient découpées etc. Ce sont mes deux premières grosses références dans le rap.
Comment un illustrateur chez Radikal se retrouve à faire la pochette du Lino ?
F : C'était une évolution logique pour ma part. J'étais un passionné d'images et à Radikal j'ai vraiment appris à maitriser les logiciels d'infographie. Et puis à cette époque, je voyais débouler les groupes de rap au service presse du magazine. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler pour des indépendants sur des logos et flyers. Dans ce microcosme qu'est le rap, si tu es motivé et créatif on peut te tester sur une pochette rapidement. Ma première pochette officielle était celle de Princess Aniès…vu que je ne faisais pas de photo, le livret ainsi que la cover étaient entièrement dessinés. Une fois le pied dans ce "game", je suis devenu accroc, et j'ai eu cette chance de travailler avec Lino assez vite.
"Je suis assez critique envers mon travail. Je dois faire un site aujourd’hui mais, pour moi, il n’y a rien à mettre dedans."
A : Avec le recul, quel regard tu portes sur tes premiers travaux ? Est-ce qu’il y a des choses que tu considères comme des ratages a posteriori ?
F : Je suis assez critique envers mon travail. Par exemple, je dois faire un site aujourd’hui mais, pour moi, il n’y a rien à mettre dedans. Finalement, je ne suis pas satisfait de ce que j’ai fait. On est dans une performance quotidienne et, à mon sens, ce que j’ai fait il y a un mois est déjà dépassé. Au départ, je bossais pas mal à l’arrache et je trouve que mes premières photos étaient floues, mal étalonnées… Mes ratages étaient surtout photographiques, n'ayant pas reçu de formation professionnelle dans ce domaine. Ensuite, quand tu bosses avec des clients, tu réponds aussi à une demande. Tu ne fais pas forcément ce que tu veux, surtout quand tu es en maison de disques…
Par exemple, tu peux te retrouver face à un mec qui n’aime pas poser. Tu vas alors être obligé de te démerder pour pondre quelque chose qui convienne même si ça ne rentre pas dans tes plans initiaux. Au final, il y a plein de pochettes que j’ai faites dont je ne suis pas forcément fan. Attention, il y en a plusieurs que j’aime également ! En tout cas, tant que je n’aurai pas une totale liberté, je ne serai pas vraiment satisfait.
A : Quel est ton meilleur souvenir ?
F : [Il hésite] Il y a eu le travail sur l’album de Mokobé, le premier album de la Fouine… Tout le travail autour de Booba avec qui je me suis vraiment éclaté en terme de création. B2O m'a toujours guidé tout en laissant libre court à mon imagination. Sur les campagnes Unkut, j'ai vraiment de bons souvenirs "photoshopiens" [rires].
Justement, je voulais revenir sur "0.9" qui a un très joli livret mais dont la pochette a beaucoup fait parler. Les précédentes pochettes de Booba avaient souvent un double sens et celle-ci n’a pas été très bien comprise par le public… Où est-ce que vous avez réellement voulu aller ?
F : Je t'avoue que je me suis fait pas mal allumé sur cette cover [rires]. Les gens s'attendaient au grain Fifou, avec des montages de partout, des effets de flairs que l'on retrouve partout… Mais avec Booba, on ne voulait faire que de la photo pure, sans forcément d'effets photoshop. On s'était déjà bien lâché graphiquement sur ses campagnes et on a donc pris le parti de réaliser une pochette épurée et simple. Mais comme je te l’ai dit, tu n’as pas forcément le veto pour dire "c’est ça et rien d’autre". C’est quand tu bosses avec des indépendants que tu as le plus de libertés. Prends quelqu’un comme Chris Macari. On lui a souvent reproché d’avoir réalisé des clips beaucoup plus forts pour des mecs ghetto que ceux réalisés pour des rappeurs plus établis. C’est sûrement dû au fait qu’il ne jouissait pas de la même liberté et je le comprends complètement.
Est-ce qu’Internet t’a aidé à percer et à te faire des contacts ?
F : Ca fait longtemps que je suis dans le rap et j’ai un réseau qui est déjà assez large. Dailleurs, comme tu as pu le remarquer je n'ai même pas le temps de faire mon site [rires]. Généralement, les rappeurs ne passent pas par Facebook mais me contactent directement. Il y a des clients qui passent chez moi et laissent du courrier dans la boîte aux lettres [rires]. Aujourd’hui, Facebook m’offre un autre réseau mais ça concerne davantage le cinéma, des graphistes ou des chefs d’entreprise que le rap.
A : Je sais que tu as été amené à travailler sur le visuel de "L’arnacoeur", le dernier film de Romain Duris et Vanessa Paradis. Comment es-tu arrivé sur ce gros projet ?
F : Déjà, j’ai toujours eu l’ambition d’élargir mon champ de compétences et d’aller voir ailleurs. Clairement, je ne m’imagine pas cantonné aux pochettes à cinquante ans. C’est cool, tu peux vraiment t’éclater sur le plan artistique mais c’est comme un mec qui fait des clips: il voudra toucher au long métrage à un moment donné. C’est la même chose pour moi, j’ai envie d’aller explorer d’autres univers. Les affiches de film m’ont inspiré pour plusieurs pochettes. D’ailleurs, la plupart des rappeurs ont des références cinématographiques quand ils viennent te voir. Le problème c’est qu’en France, quand tu bosses avec les rappeurs, c’est un peu compliqué d’aller se revendre ailleurs. Je pense que des gens comme Armen ou Koria doivent rencontrer le même problème. Il y a de grosses barrières dans le cinéma français. Le fait de travailler dans l'urbain peut bloquer avec certains milieux.
Pour en revenir à "L’arnacoeur", je n’ai jamais démarché personne. J'étais avec mon ami David Danési, le patron de Digital District qui m'a mis en contact avec le réalisateur Pascal Chaumeil et Nicolas Duval, patron de Quad. Je ne m'attendais pas à rencontrer autant de personnalités lors de mon premier rendez vous avec eux. Ils m'ont projeté le film dans une mini salle de visionnage très cosy de leurs bureaux. Le briefing fut rapide : de gros enjeux économiques étaient investis et j'avais peu de temps pour réaliser l'affiche. Grosse pression donc et surtout pour une première. De plus, avant de les quitter, on m'apprend que c'est Monsieur Mondino qui avait réalisé le shooting lors de la première séance (non validée pour l'affiche)… Ca m'a mis encore plus de pression sur les épaules. Mais au final, tout s'est bien déroulé et le film a explosé le box-office.
"Pour "L'Arnacoeur", le briefing fut rapide : de gros enjeux économiques étaient investis et j'avais peu de temps pour réaliser l'affiche."
A : Quelles différences vois-tu entre l’industrie du disque et celle du cinéma ?
F : La grosse différence c’est qu’il y a énormément de paperasse dans le cinéma, surtout quand c’est un gros film. Et forcément les budgets n'ont rien à voir avec la musique. C’est également un univers qui est très codifié. Là il s’agit d’un gros film qui marque le retour de Vanessa Paradis, c’est une grosse comédie française… Généralement, les affiches de comédies françaises ont toujours les mêmes codes couleurs. Le souci avec ces gros films c’est que tu dois plaire au réalisateur, aux acteurs, aux producteurs, au public… A tout le monde ! Tu as quinze personnes devant toi qui vont juger ton travail. J’ai fait un gros travail pour le film mais qui a quand même été recalibré par derrière : les couleurs ont été changées, la typo est devenue super basique parce que la mienne était trop compliquée…
Bon, je n’ai jamais bossé avec Jay-Z et il se peut que ça soit le même délire mais, dans la musique, je n’avais jamais été confronté à ça. Généralement, les maisons de disques font quand même confiance à l’artiste, surtout quand il s’agit de Booba par exemple. Si ce que je fais plait à Booba, c’est réglé. En même temps, ça m’a permis d’apprendre et de me frotter à un autre milieu.
Si des opportunités se présentent, j’imagine que tu aurais envie de continuer à creuser dans ce milieu…
F : Ouais, j’ai envie de m’y mettre à fond, cette expérience m'a vraiment motivée. Aujourd’hui, quand je bosse sur une affiche de cinéma, je ressens les mêmes vibrations que lorsque je commençais mes premières pochettes. Il y a une étincelle, ça m’inspire ! Et voir son affiche partout dans la France et le monde est une sensation terrible!
On a interviewé Armen il y a peu qui nous disait qu’il avait surtout envie de bosser sur la réalisation de clips aujourd’hui, notamment aux États-Unis. Est-ce que c’est quelque chose qui te tente ?
F : Oui bien sûr. Avec la technologie d'aujourd'hui, il y a vraiment matière à s'éclater en vidéo. Pour moi, c'est une évolution logique pour un directeur artistique ou photographe. Mais j'ai besoin d'apprendre aussi bien en photo qu'en vidéo pour vraiment me lancer dedans. Petit à petit...
Est-ce que la musique de l’artiste intervient dans la création de la pochette ? Par exemple, quand tu fais la pochette de l’album de Lino, est-ce que tu as écouté l’album avant ou ça vient juste d’une demande de sa part ou d’une de tes idées personnelles ?
F : Je n’ai pas réellement besoin d’écouter l’album pour livrer une pochette sauf quand le MC a vraiment un univers particulier. C’était le cas avec Despo pour lequel on a livré un très gros travail. Déjà, je ne suis pas proche de tous les rappeurs avec qui je bosse mais Despo est devenu un ami. On a beaucoup discuté en amont, j’ai écouté sa musique et on a essayé de sortir quelque chose qui corresponde à son univers. Après, je n’ai pas le temps d’écouter tous les albums compte tenu de la quantité de projets que je fais. Quand je travaille sur un projet, j'ai besoin d'avoir une dose de mystère sur un artiste, pour pouvoir intervenir avec plus d'objectivité sur son artwork.
Tu es donc une des rares personnes qui a écouté l’album de Despo… [NDLR : l’interview a été réalisée avant la sortie de l’album]
F : Ouais et, honnêtement, ça faisait longtemps que je n’avais pas écouté du gros rap comme ça. C’est une tuerie. D’ailleurs, j’aime bien l’état du rap français aujourd’hui. Il y a énormément de rappeurs et de compétition mais du coup, tu es obligé de te démarquer quand tu sors un projet. Il faut que tu sois fort. Les nouveaux albums que j’ai entendus démontent. Que ça soit le Despo ou le Nessbeal, ce sont des putains d’album. C’est pour ça aussi que je reste dans le rap français et que ça m’intéresse toujours. La nouvelle école du rap français me motive aussi… Des artistes tels que Still Fresh et Dosseh sont à surveiller de près.
Tu disais justement que certains rappeurs français avaient tendance à avoir des pochettes super ressemblantes les unes par rapport aux autres. Est-ce que tu les trouves frileux en termes d’image ?
F : Pour beaucoup de rappeurs, leur taf se limite à rapper. Finalement, ils ne s’intéressent pas vraiment à l’image. Ça n’est pas de la frilosité mais plutôt un manque de créativité. Au final, ils ne veulent que de belles photos et se ramènent tous avec les mêmes lunettes, le même délire Louis Vuitton et les mêmes références. La plupart du temps, les groupes qui viennent me voir me demandent toujours la même chose et n’osent pas vraiment partir dans de nouveaux délires. Je pense que c’est d’abord une question de culture. Il y a quand même des groupes qui sont venus me voir et qui ont une passion de l’image, qui collectionnent des photos etc. Ça reste cependant une minorité. C’est pour ça que si tu me demandes ma pochette préférée, je choisirais sûrement une pochette super épurée avec une typo clean qu’on voit à peine. Mais les rappeurs ne me demandent pas ça généralement [sourire].
Est-ce qu’on peut parler chiffres et évoquer le budget requis pour avoir une pochette de Fifou aujourd’hui ? Est-ce que c’est le même budget pour tout le monde ?
F : En règle générale, une pochette en indépendant ira de 1 000 à 1 500 euro tout compris. En maison de disque, ça commence à 5 000 et ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. Dans le cinéma, les chiffres n’ont rien à voir puisque tu vas prendre avec une affiche l’équivalent de quatre pochettes de disques. Ça paye bien !
Est-ce qu’il y a un motif autre que financier qui pourrait t’empêcher de réaliser une pochette ?
F : Je travaille beaucoup au feeling. Je considère mon travail comme une chance, donc j'aime bosser avec tout le monde, je ne snobe pas du tout. Cependant, j'aime triper humainement avec mes clients. S'ils sont distants ou pédants, je ne travaillerai pas avec eux. En tant que photographe, certains détails peuvent aussi me bloquer. Si mon client ne dégage rien physiquement, j'aurai du mal à faire quelque chose de puissant. Avoir des statues sans feeling face à mon objectif ne me booste pas trop.
Est-ce qu’il y a des pochettes de rap ou des affiches de film qui t’ont vraiment marqué ?
F : Plusieurs mêmes! J'ai adoré le travail de Wahib avec la Mfia K'1 Fry et ses couvertures du magazine The Score. Sinon mes références sont rarement Hip-Hop. Je puise mes inspirations dans l'univers de la mode et du cinéma. Les visuels des séries américaines sont explosifs! J'hallucine sur les concepts des affiches des "Soprano", "The Wire" ou "Dexter". Dernièrement, en affiche, je suis resté bloqué sur les créas de l'affiche "Inglorious Bastard" de Tarentino. Tous les univers m'inspirent, je m'intéresse de plus en plus au travail incroyable du graphiste So-Me de Ed-Banger.
Pour revenir un peu sur quelques-unes de tes créations, comment en êtes-vous arrivés à créer la pochette et le livret de "Paradis assassiné" de Lino ?
F : A cette époque-là, j’étais un petit puceau et c’était un rêve de fou de pouvoir bosser avec Lino. Il fait partie de ces rappeurs qui bouffent énormément de films, qui bouquinent 24H/24, qui regardent tout ce qui se passe sur Internet… Il est arrivé en me ramenant des affiches de film et des idées de photos. Ensuite, on a beaucoup bossé au feeling. Par exemple, on a fait la photo Punisher et, d’un coup, il me dit "Viens, on va mettre des cadavres autour !" Il ne s’agit pas de pochettes dessinées au préalable. On avait posé un univers au départ mais qui a évolué au fur et à mesure. Lino est un vrai kiffeur de l’image et c’était un plaisir de bosser avec lui. C’est un des rares avec qui j’ai vraiment pris mon pied graphiquement.
Parmi les autres pochettes que j’apprécie, il y a "Rimes passionnelles" de Stomy qui était très soignée. Comment en êtes-vous arrivé à ce délire ?
F : A cette époque-là, Stomy avait changé de mode de vie dans le sens où il était déjà acteur et avait fait de nombreux films. Quand je suis allé le voir, je ne voulais pas faire une photo de lui avec un bandana même si c’est le Stomy qu’on connaît. Je voulais vraiment mélanger le côté classe et caillera. J’ai pensé à cette pochette comme une peinture, notamment la photo dans la chambre d’hôtel où on voit une femme allongée sur le lit. Ça correspondait à l’image qu’on avait de Stomy mais ça n’envoyait pas le même message qu’une pochette de Ice-T avec des gros nibards partout. Ici, il y avait un côté plus poétique. Ce qui était bien c’est que Stomy est très bon client face à l’objectif, qu’il aime poser et qu’il m’a laissé prendre mon temps. Il m’avait aussi donné carte blanche pour ce projet.
Je sais que tu as également travaillé avec Princess Aniès. Est-ce qu’il y a des codes différents en termes d’image quand tu bosses avec une femme ?
F : Les codes sont les mêmes mais cela se travaille différemment. Dans le rap c'est plus difficile pour une femme…Elle est soit classée dans le rap de bonhomme, soit dans ce côté bitch provocatrice à la Lil Kim. Ensuite niveau préparation d'un shooting il y a beaucoup plus d'intervenants. Contrairement aux mecs, une rappeuse doit avoir une maquilleuse, une coiffeuse et un styliste. C’est sûr qu’il y a beaucoup plus de préparation pour une fille que pour un mec. Quand tu as six heures de studio avec Sheryfa Luna, il y a deux heures qui sautent pour le maquillage.
J’ai vu que tu avais fait la pochette de "Un homme nature" de Gyneco. Comment s’était passée cette collaboration ?
F : A l’époque, j’avais pas mal bossé avec un label canadien qui s’était implanté en France sur lequel il y avait Papillon et les Sales Gosses. Même si eux étaient en beef avec lui, on m’a contacté pour retoucher la pochette de Gyneco. Il faut savoir qu’à sa grande époque, Gyneco était le rappeur que je voulais shooter à tout prix, au même plan que des NTM ou IAM. Quand je l’ai rencontré, il était encore dans le rap mais il était déjà ailleurs. On n’a pas vraiment échangé, je n’avais même pas écouté l’album…Je commençais déjà à bosser avec des gens comme Mac Tyer et quand je lui montrais ce que la nouvelle école faisait, cela ne lui parlait plus du tout. Je me rappelle d'un gars tranquille et posé mais plus trop impliqué dans sa musique.
Tu es passé de pochettes très esthétiques à des travaux beaucoup plus street. Comment se fait la transition ?
F : Pour moi, c’est quelque chose de purement Hip-Hop. Il y a des projets où le rendu doit être "crasseux". Je ne dis pas ça péjorativement et ça ne signifie pas que ça doit être bâclé mais le contenu du disque t’oriente vers ça. En plus, il s’agit souvent de projets sur lesquels il y a moins de moyens. Mais c’est la même chose aux Etats-Unis ou le visuel d’une mixtape n’a rien à voir avec celui d’un album. Parfois, les mecs viennent me voir et veulent un truc caillera, super simple. Je vais le finir en deux heures de temps. Par exemple, je bosse avec Escobar Macson qui prépare deux projets en même temps. Un street sur lequel le visuel sera super caillera, super simple. De l’autre côté, il prépare son album pour lequel on a bossé la pochette sur trois mois et on s’est vraiment pris la tête. Les deux sont cohérents et représentent une facette d’Escobar. Ça m’éclate de différencier deux types de pochettes.
Pour revenir un peu sur ton actualité à venir, tu me disais que tu avais ces quatre projets des dessins animés. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail et nous dire de quoi il s’agira ?
F : Actuellement avec mon équipe, on travaille sur une série courte appelée "Moniz". Le principe est d'animer des billets de banques qui parlent entre eux de l'économie actuelle sur un ton moqueur et sarcastique. Une sorte de brèves de comptoirs entre différents billets qui se retrouvent au fond d'une poche. Je m'occupe de la création des personnages ainsi que de la bible graphique, et le scénariste Clark travaille sur leurs mises en scène et dialogues. En parallèle, comme je le disais plus haut, on travaille sur le projet Baby Hip-Hop afin de l'implanter sur le territoire US. Ce projet est plus complexe, car il est très large. On réfléchit sur la gamme textile pour enfant, sur le prochain album, et sur tous les dérivés du projet. Pour les autres projets, on met en place un collectif du nom de Fish High, dans lequel on pourra produire des documentaires, des projets d'éditions et de communication visuelle. Le but étant de travailler avec de nouveaux talents et surtout de s'éclater à plusieurs.